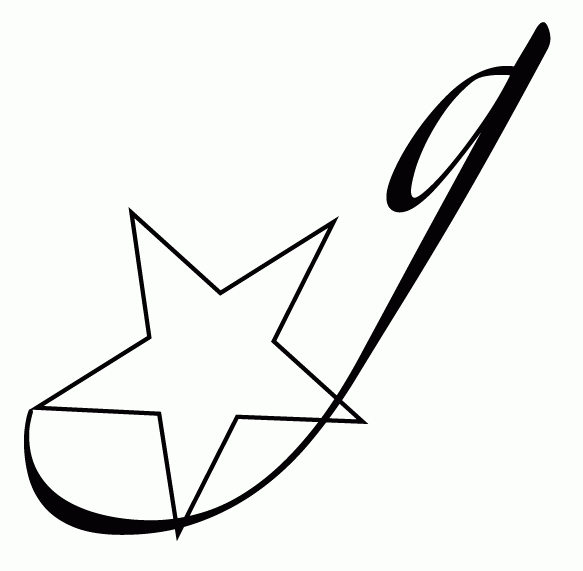Cette rentrée de janvier rappelle celles de septembre dans le monde d’avant le covid. Les écrivains y sont conviés tour à tour, saturant, pour les plus connus d’entre eux, les unes et les papiers des cahiers livres. Cette semaine, au menu, c’est Marie Ndiaye et Julien Gracq. Deux figures d’écrivains, deux inédits.
Teaser Audio de la semaine
LES UNES
« Que les nuits d’automne tombent plus tôt, il en retire de la volupté. Mais la disparition des jardins potagers à l’approche des bourgs le désole ». De qui s’agit-il ? De Julien Gracq.
De retour dans l’actualité pour la publication d’une partie de ses carnets posthumes, et demandés comme tels par l’auteur qui aurait préféré que l’on attende 2027 pour les publier, dixit Jean-Claude Raspiengeas en une de La Croix. On y retrouve une galerie de paysages aimés ou détestés par l’écrivain avec quelques apartés sur les idées ou l’enfance : « Quel arpenteur parviendrait à dessiner avec autant de finesse et d’acuité le cadastre si mouvant des rives de la Loire ? » Il semble que l’on renoue ici au plus près avec l’esprit de Gracq, mieux que lors de la parution des Terres du couchant, roman plus touffu et peut-être « trop écrit ».
On ne s’étonnera donc pas de retrouver également Gracq dans le dossier du Figaro Littéraire. Echappant à la postérité académique de la « Pléiade » ce sont les textes vivants de Gracq que contient Nœuds de vie. Des textes qu’il n’avait pas retenus pour d’autres œuvres comme l’explique Bertrand Fillaudeau sans être des fonds de tiroirs pour autant.
Thierry Clermont nous l’assure, on retrouvera chez Gracq celui qui « s’attarde sur le règne végétal, les ciels changeants, la marche des nuages » et d’un autre côté celui qui développe « des réflexions sur la mécanique romanesque, des sensations et des souvenirs d’enfance ou de garnison (…) et quelques formules bien frappées ». Comme son collègue de La Croix, il souligne la présence des paysages bien connus, de la Sologne aux bords de la Loire en passant par des terroirs plus obscurs mais qui n’échappent pas aux relevés topographiques de l’écriture gracquienne.
Samedi dans LibéL c’était déjà la rentrée de janvier… dont on sait que la figure de marie Ndiaye lui servira de figure de proue. Son roman, La vengeance m’appartient sonne comme un avertissement et le fait divers à partir duquel il est construit nous convoque au chevet du drame contemporain : la mère infanticide, le père insupportable ; nouveauté, l’avocate, contactée par le père reconnait en celui-ci une figure trouble de son adolescence.
Claire Devarrieux ne nous dit rien de l’intrigue policière dans son dénouement mais va assez loin dans l’interrogation des personnages notamment celui de Sharon la femme de ménage mauricienne, sans papiers qui travaille chez l’avocate. « C’est un grand personnage propre à faire jouer les rapports de force, les ressorts de la honte et de l’humiliation, armés comme d’habitude avec une délicatesse infinie par Marie Ndiaye. » Un entretien avec l’écrivain complète le lancement de l’œuvre, une Marie Ndiaye en mode Modiano qui avoue son goût pour les faits divers, des auteurs assez rares comme Hélène Bessette ou Laurent Albarracin. Le Monde des Livres va un peu dans le même sens même si Raphaëlle Leyris dit « on ne saura jamais à qui fait référence sa première personne, ni de quelle vengeance précisément il s’agit »
Les lectures critiques sont à écouter dans notre billet audio !
Sophie Joubert nous propose de commencer l’année avec « la folie de la mère, l’absence du père, un amour maternel fusionnel et toxique, la brutalité des rapports humains. » autrement dit avec le dernier roman de Nathalie Kuperman dans lequel une mère emmène sa fille au bord de la mer (quasi de force) et lui fait passer de vacances assez catastrophiques. Mais On était des poissons se retourne dans une 3eme partie nous dit la critique, remettant en question l’aspect négatif du comportement maternel pour l’expliquer, l’examiner au prisme des « injonctions contradictoires que la société fait peser sur les femmes. » Ce n’est pas du fait divers mais on s’en approche.
Ivan Jablonka poursuit son parcours atypique dans un nouvel ouvrage Un garçon comme vous et moi.
Cette fois c’est lui-même qu’il met en scène, son éducation élitiste, obligée, qu’il compare à celle de Louis XIII excepté que ses parents à lui sont juifs : « Il n’est pas certain que l’héritier de la Couronne ait été davantage aimé que l’héritier de la Shoah. Nous avons tous les deux reçu une éducation royale. » Virginie Bloch-Lainé souligne sa volonté d’abdiquer sa propre domination masculine allant vers une identité moins affirmée et qui mènerait, du même coup à « son attachement à ces valeurs positives » que sont la liberté, l’égalité, le féminisme, etc. Une remarque rapportée par la critique souligne l’ambiguïté de la démonstration : l’héritage de deux expériences « La première consistait à passer des étés sur une plage naturiste avec ses parents, du côté de Cassis. Le « cul nu » et les bedaines faisaient obstacle à la phallocratie, assure Jablonka. », la seconde sera une année de CP en Californie qui lui ouvre des horizons. Entre Histoire, sociologie, fait-divers et création littéraire Jablonka ne cesse de vouloir faire « bouger les lignes ».
Dans le pêle-mêle :
voici encore Marie Ndiaye, version La Croix et le Figlitt cette fois ; des papiers, pas de une, enthousiastes cependant « un roman d’une intensité inouïe » dans le premier, tandis que Mohamed Aïssaoui souligne l’extrême acuité des personnages. Tiffany Tavernier complète cette semaine dévolue aux drames familiaux et autres faits divers avec L’ami, chroniqué par Muriel Steinmetz pour l’Huma ; roman dans lequel un couple découvre que ses voisins dont il sont assez proches sont un tueur en série et sa complice et que des corps sont enterrés dans le jardin bien tenu. Des noms d’écrivains de janvier dont on devrait entendre parler, en voici en voilà qui apparaissent, Patrick Grainville, Ann Patchett, Andreï Makine.
La critique critique cette semaine c’est pour Bernard Pivot dans La Croix sous la plume de Jean-Claude Raspiengeas qui après avoir titré sur « un roman vivifiant et désenchanté sur son entrée en vieillesse » offre une petite restriction : « Faut-il taire néanmoins la déception qui gagne au fil des pages, d’assister au relâchement du style, à l’étalage d’une platitude que toute une vie passée à côtoyer les meilleurs écrivains de son temps aurait dû conduire à éviter. Par défaut de profondeur autant que d’exigence romanesque, une certaine banalité érode le texte, soulignée par des traits d’esprits assez poussifs. » Vivifiant on vous dit.