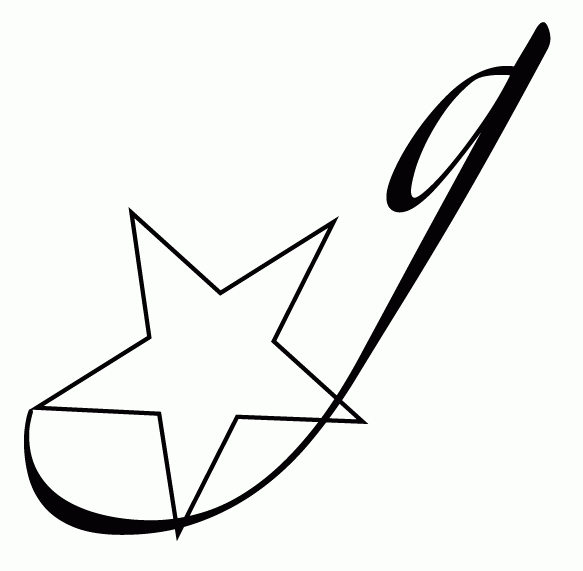Revue de presse du 4 au 10 octobre 2025
Tableau des parutions en fin de chronique
La semaine du 27 septembre au 3 octobre n’a pas été couverte, faute de combattants !
par Frédéric Palierne
dessins Jean-Marc Vulbeau
correction Cécile Lorgeoux
mise en ligne Jacques Chaumet
Nous ne sommes plus tout à fait dans l’actualité vibrante mais des figures se détachent encore cette semaine comme Anne Serre dont le roman, inclassable, ressemble à une suite de nouvelles, genre dans lequel elle excelle. Proust et Pasolini sont également de la partie, comme Les Rendez-vous de Blois qui ouvrent la saison des événements, pour l’histoire.

Anne Serre
Les Unes
Bien loin de la rentrée à proprement parler voici Anne Serre qui revient avec un recueil de nouvelles qui tournent autour d’un seul personnage, l’autrice, mais sous de multiples identités et Anne Serre « touche volontiers aux tabous contemporains, nous dit Muriel Steinmetz du Rendez-vous des livres. Les couleurs sont franches. Pas d’euphémismes ni de litotes pour dire la jalousie entre femmes, l’absence de solidarité de genre, la méchanceté. » C’est un livre difficile à définir même si revendiqué roman : des textes s’enchaînent qui présentent la narratrice à différentes étapes de sa vie mais sans ordre chronologique. Elle ne néglige aucun sujet et progresse dans cet étonnant livre sans tenir compte des règles de base, « les hommes, nous dit par exemple la critique, sont des objets sexuels ou sentimentaux, en aucun cas des compagnons de vie à deux. »
« Longtemps il fallait se lever de bonne heure pour lire Du côté de chez Swann. » C’est le début ironique de l’article que consacre Mathieu Lindon à l’édition de la correspondance que Proust entretient avec ses éditeurs. Grasset d’abord, et à compte d’auteur, puis chez Gallimard. Il est vrai que le rapport qu’entretient « l’homme le plus compliqué de Paris » dixit Grasset avec la publication, le contrôle sur le fait de rendre son texte public, est parfois à la limite du comique : ponctuation, taille des caractères, corrections des typographes à son insu, tout l’irrite : un tableau licencieux devient selon lui un tableau silencieux ce qui le désole. Amusant également le regard qu’il porte sur sa propre œuvre et qu’il ne cesse de reprendre : « Je ne sais si je vous ai dit que ce livre était un roman. Du moins, c’est encore du roman que cela s’écarte le moins. Il y a un monsieur qui raconte et qui dit : Je ; il y a beaucoup de personnages ; ils sont « préparés » dès ce premier volume, c’est-à-dire qu’ils feront dans le second exactement le contraire de ce à quoi on s’attendrait d’après le premier ».
A l’occasion de la publication de la version illustrée de Terre des hommes par Riad Sattouf, le Figaro littéraire consacre un dossier aux œuvres littéraires illustrées, et il semble bien qu’il s’agisse d’une réelle tendance. D’un côté Tolkien, Sepúlveda, de l’autre Tove Jansson, créatrice des moumines, et Joanna Concejo. De la qualité donc, de l’originalité également avec la rencontre entre le Giono de L’Homme qui plantait des arbres et Eva Jospin. Du même coup ce canular reposant sur le portrait d’un homme qui n’a jamais existé prend un tour particulièrement poétique sous l’apport de la plasticienne très «orientée nature». Quant à Garcia Márquez, il est « librement adapté, et avec un talent chatoyant par l’illustrateur italien Ugo Bertotti », nous dit Thierry Clermont. C’est d’amour aux temps du choléra qu’il s’agit, un texte dixit GGM « écrit pour une poignée d’amis ».
Sylvain Venayre, historien, s’improvise critique dans le LibéJ, critique d’un livre consacré à la chronique-roman familial ayant la guerre d’Indochine pour cadre ; pas étonnant : « Ainsi tremblent les frontières entre le narrateur et l’auteur, entre l’imagination et les événements historiques ». Tout part d’une correspondance restituée, lettres, journal intime et télégrammes. Le narrateur, un certain Paul Sanzach s’engage en Indochine après avoir été résistant. S’ensuivent des récits de destins croisés qui contribuent à donner une idée de la diversité des vocations entre aventuriers et soldats perdus : « existences représentatives d’une époque et d’une guerre dont seul l’art poétique d’Adrien Genoudet attesterait la réalité. »
A la suite du Monde des livres et avec LibéJ, Livres et Idées souligne le partenariat de La Croix avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Pas de véritable une mais un article après une déclaration d’ordre général sur l’importance de l’histoire et le thème du roman national, celui de l’année. Un article de Béatrice Bouniol consacré à la France éternelle de Jean-Paul Demoule. Elle en souligne toutes les aspérités, les remises en question des représentations sur la France : « S’ils habitent en partie sur notre territoire actuel, Homo erectus, sapiens ou premiers agriculteurs venus du Proche-Orient ne forment pas un embryon de nation. Tout comme les Gaulois qui ne sont pas davantage nos ancêtres que les Belges ou les Tchèques. Quant à nos racines chrétiennes, elles remontent plutôt à la conquête romaine qui introduit à un monothéisme unique. » Elle souligne le bien-fondé de la base archéologique qui permet d’ouvrir l’éventail des alternatives au roman national, ou au concept de France éternelle mais signale que c’est moins « convaincant » pour le XX et XXIe siècle.
« Pasolini était profondément anarchiste. En cela il devrait être irrécupérable » nous dit René de Ceccatty dans l’entretien qu’il accorde à Amaury da Cunha. Son recueil de poèmes Transhumaner et organiser est traduit plus de cinquante ans après sa parution et pour le cinquantième anniversaire de la mort par assassinat de Pasolini. Le terme transhumaner vient de Dante et signifie « le dépassement mystique de la condition humaine ». C’est un Pasolini seconde manière, sombre, qu’il évoque l’amour perdu de son amant, principal acteur de ses films ou l’attentat néofasciste de la Piazza Fontana à Milan. « Dans ce poème, la voix de Pasolini accueille celle de Saint-Jean. Il entrelace des citations de l’Apocalypse et de courtes nécrologies des victimes. »
Dans le Pêle-Mêle
Pour info, Anne Serre figure également dans le Figlitt de la semaine sous le titre Autoportrait envoûtant. Et dès le 4 septembre dans la chronique tenue par Tiphaine Samoyault pour le MDL : « Elle est certainement à la lisière du conte, et c’est la magie d’Anne Serre que de nous installer sur ce seuil, une « zone étroite et précise » où l’on peut être en « adéquation quasi parfaite » avec ses désirs. »
David Diop fait partie des auteurs dont l’ouvrage marque la rentrée : les racines égyptiennes du Sénégal y sont évoquées sur un mode romanesque, mais l’œuvre montre recherches et profonde culture. Une civilisation serait ainsi née du transfert d’une autre, une immigration culturelle et technologique réussie en somme, pour le dire à gros traits.
Une semaine à nouveau riche dont l’abondance aurait permis de faire les trois rentrées précédentes.